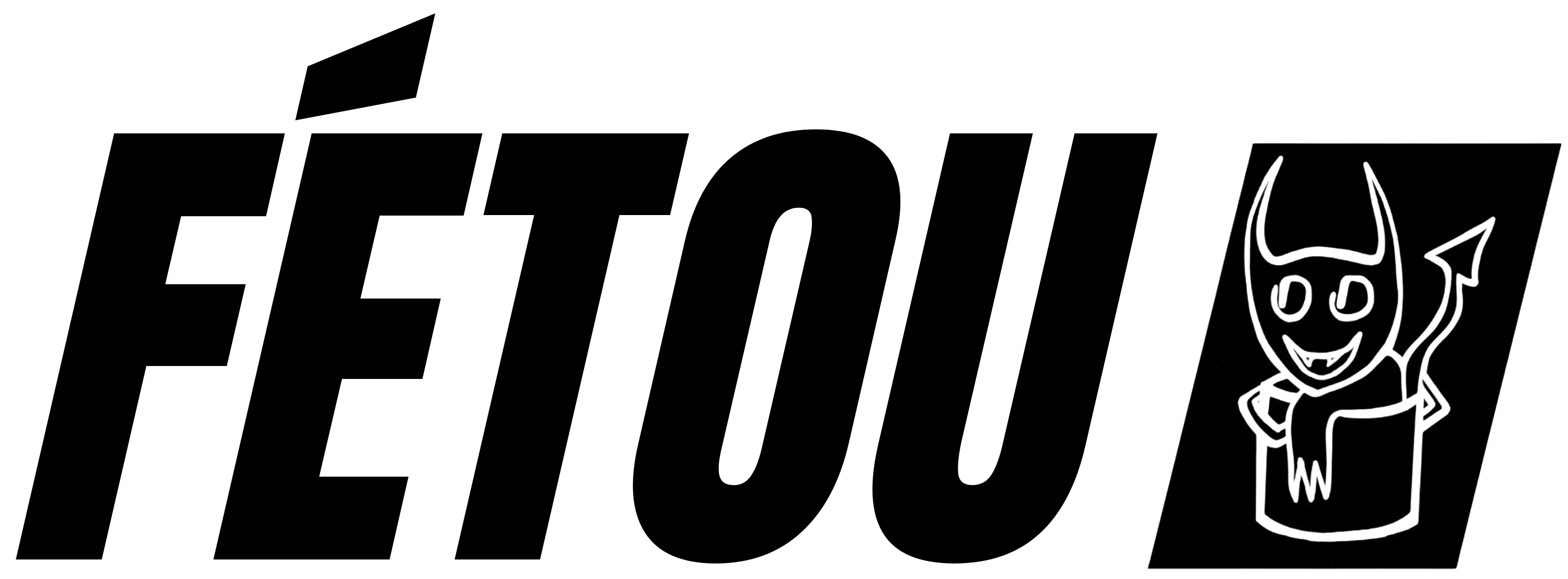Premières années
Le souffle de vie en moi s’exprimait avec aisance ; il ne me fallut pas beaucoup de temps pour
ramper, puis marcher et enfin courir. J’incarnais ce corps neuf comme si j’avais toujours été. Je
découvrais avec joie que j’étais nulle part et partout à la fois, jusqu’à ce que tout se concentre
enfin en une seule enveloppe qui m’avait été donnée, façonnée sur mesure. Tout était si
extatique !
Le soleil pénétrait ma peau avec désir, la pluie me battait les pores, mes pieds nus
s’imprégnaient du terreau humide, mes orteils s’enfonçaient volontiers dans le sable chaud.
L’eau glacée des torrents malmenait mes membres et je me laissais emporter par les rivières,
pétrie par les roches glacées. J’apprenais la douleur. Je touchais aux plaisirs. Je m’appropriais la
vie.
Je débutais alors une existence vagabonde, pleine de malice et d’innocence. De naïveté.
J’aimais dormir dans les arbres avec les poules, qui caquetaient lorsqu’elles sentaient ma
présence. Et, telle une puce, je me nichais sous leurs ailes, passant les nuits fraîches
suspendue avec elles. Leur chaleur, sous leurs plumes brunes, dégageait une effluve douce et
chaude qui me réconfortait.
Et les odeurs ! Elles existaient par milliers, simultanément : celles des troncs après la pluie, de
la terre rafraîchie, des bourgeons qui éclosaient, des pistils butinés, de l’argile qui s’étalait, de la
rouille qui s’étiolait, du bois sec et travaillé… Et aussi les plus prégnantes : les excréments de
mes congénères, le sang, les cadavres… Il existait tout un univers de phéromones dans lequel je
baignais. Elles nous collaient à la peau, s’incrustaient dans le nez et le palais, s’y installaient et
venaient titiller le cerveau.
J’humais avec délectation certaines de ces fragrances offertes, surtout les plus sucrées. Elles
me menaient aux fruits — mangues, caramboles, merises, avocats, pommes d’eau, corossols,
chadec, jacques… — que je dévorais goulûment, emplissant mes entrailles de leur suc vivifiant.
Puis je m’assoupissais, le ventre tendu, sur une branche, sous une tôle ou parmi les souris.
Et de nouveau, le matin, je bondissais de branche en branche, telle une tique avide de
sensations. Du sommet des fromagers, j’observais, attentive, les rayons solaires apparaître et
disparaître, les feuillages s’animer sous l’embrasure du vent, les fleurs légères virevolter en
cascade, et les gigantesques nuages insaisissables se mouvoir, survivant aux écrasants mornes
pointus… ou disparaissant en une multitude de particules fines de brouillard.
Vous l’auriez compris : je ne m’approchais pas tout de suite des humains. À dire vrai, je me
retrouvais effrayée face à leur énergie instable, imprévisible, sens dessus dessous. Je leur
ressemblais en tout point, sans pourtant y trouver aucune similarité : ils étaient à mes yeux
comme des anomalies sans but, des êtres difformes habillés de toiles, chaussés de cuir, coiffés
de pétrole, amasseurs de métaux et d’objets de toutes sortes. Ils ne se couchaient pas
forcément avec le crépuscule, mais devaient se lever à l’aube. Ils se nourrissaient de choses
non identifiées, aux odeurs bizarres, aux couleurs et aux formes étranges. Ils établissaient avec
les autres êtres un rapport d’intérêt égoïste et se positionnaient en dominateurs. Ils marchaient
de pas lourds, couraient à l’intérieur de rectangles pendant des heures, utilisaient des engins
qui ne produisaient rien et qui, simplement, prenaient : du temps, de l’attention, de l’énergie.
Des individus qui déambulaient avec angoisse d’un lieu à l’autre, en quête de quelque chose (de
quoi ?) pour s’installer dans des carrés blancs et stériles, effectuant les mêmes actions, répétant les mêmes phrases, dans des véhicules qui dégageaient une odeur écrasante, morbide
et moite.
Qu’est-ce que cela signifiait ?
Il me semblait y voir des parasites. Des miasmes qui pullulaient de part et d’autre, inarrêtables,
qui ne pouvaient que se multiplier, vampiriser pour se pérenniser.
Un soir, du haut d’un prunier, j’observais l’un de leurs rituels : de nombreux véhicules faisaient la
queue bruyamment. Ils circulaient lentement. Les personnes semblaient bien embêtées : elles
voulaient avancer mais ne le pouvaient pas, bloquées par devant et par derrière. Je
m’interrogeai sur cette situation absurde :
« Pourquoi procéder de cette manière, alors qu’elles peuvent passer à gauche, à droite, faire
demi-tour, ou tout simplement sortir de leur habitacle, le laisser là et s’en aller ? »
Une voix calme, inconnue, me répondit alors :
— Comment pourrait-il en être autrement ?
Surprise, je me retournai et aperçus sur une branche un de mes semblables. C’était la première
fois depuis ma venue au monde que j’en rencontrais. Il ne me regardait pas. Sans émotion, il
fixait ce spectacle chaotique. Le poil hérissé, je ne répondis pas. Il continua :
— Si tu veux comprendre ta mission, il te faudra comprendre leurs codes.