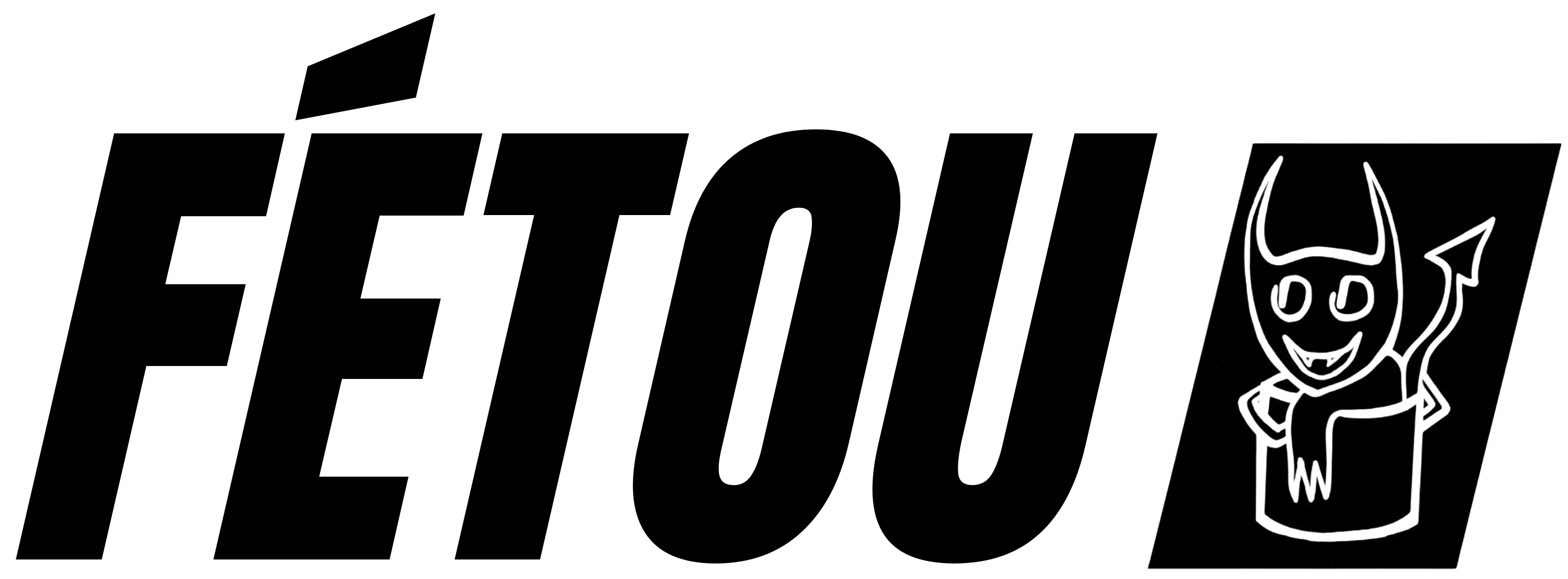Maureen Coipel-Sarotte
Alaa El Aswany, écrivain égyptien de renom, est reconnu pour ses œuvres majeures qui témoignent des épisodes révolutionnaires de l’Égypte contemporaine. Il s’est fait connaître notamment avec son premier roman L’Immeuble Yacoubian (2002), adapté au cinéma en (2006). Ses écrits, qui livrent une critique incisive des réalités politiques et sociales de son pays, sont aujourd’hui censurés en Égypte (ainsi que dans de nombreux pays arabes) pour « insulte envers le président, les forces armées et les institutions judiciaires égyptiens ».1
J’ai couru vers le Nil nous plonge au cœur de la révolution égyptienne de 2011 sur la place Tahrir au Caire. Cette fiction mêle la grande Histoire à la petite histoire, et nous éclaire sur les coulisses de cet événement historique où une mosaïque de personnages issus de milieux sociaux et économiques variés a vu sa vie bouleversée par la révolution — y compris celles et ceux qui auraient préféré que rien ne change. Cette fresque polyphonique met en avant des portraits sociaux bien définis, incarnant soit une dévotion totale au régime, soit une opposition radicale à celui-ci.
L’ingéniosité narrative d’El Aswany se manifeste dans la manière dont il retranscrit l’impact des bouleversements politiques jusque dans les conversations les plus intimes de la vie privée de ses personnages. En passant, d’une étudiante en médecine, fille du général des forces armées, à un syndicaliste d’une usine de béton, puis par un bourgeois copte 2confronté à la corruption du milieu cinématographique, ou encore une journaliste musulmane chargée de la propagande d’État, El Aswany dresse un tableau nuancé de la société égyptienne, tiraillée entre lâcheté, engagements héroïques et hypocrisie religieuse.
Bien qu’original, faire ce virage de l’Egypte à la Martinique, nous fournit de la matière pour revisiter certaines problématiques sous un autre angle. Il permet d’interroger, entre autres, l’instrumentalisation de la démocratie dans des contextes postcoloniaux, les formes d’engagement militant souvent héroïques mais usantes face à la difficile mobilisation des masses, ou encore le rôle de la propagande médiatique dans le maintien de l’ordre établi. C’est l’occasion de prendre du recul et de déplacer notre regard sur le monde depuis notre propre lieu d’énonciation, dépi tjè péyi nou.
La démocratie a bon dos !
Mon propos ici n’est pas de remettre en cause la démocratie dans son principe même, mais bien de souligner comment elle peut être instrumentalisée comme outil de domination.
Dans J’ai couru vers le Nil, un même mot – la démocratie -revêt deux visions opposées. Pour les révolutionnaires, elle incarne l’espoir d’une société plus juste, débarrassée de la corruption, de la dictature militaire et des manipulations religieuses. Tandis que, pour les partisans du régime, elle représente une menace, un « complot méprisable » importé par l’Occident pour détruire le pays. A cette époque, l’État égyptien nourrit un discours binaire opposant l’Orient à l’Occident, qu’il rend responsable des maux qui gangrènent le pays. Cette rhétorique, enracinée dans l’histoire coloniale, justifie la diabolisation des puissances occidentales à travers la construction d’une frontière idéologique qui se distingue de l’Occident : les coutumes traditionnelles vs les idéaux modernistes, la piété religieuse vs la laïcité, l’autorité vs l’esprit critique. Une logique qui permet de rejeter certaines valeurs, comme la démocratie, présentée non pas comme un droit universel, mais comme une imposition étrangère ou occidentale. L’un valant l’autre dans cette vision binaire où tout ce qui vient de l’extérieur est perçu comme une menace. Dans le récit, les révolutionnaires sont accusés d’être payés par l’Amérique ou Israël, et assimilés à des traîtres complotant contre l’Etat.
Cette contradiction dans le regard des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires souligne un point central : la démocratie n’est pas neutre (notamment en contexte postcolonial). Elle peut revêtir plusieurs habits, être mise en scène comme décor institutionnel et vidée de sa substance dans le but de maintenir l’ordre et le pouvoir en place.
Et même dans un contexte démocratique formel comme en Martinique (territoire régi par les institutions de la république française), on observe la reproduction de logiques coloniales sous des habits démocratiques pour rejoindre un intérêt similaire, lié au maintien de l’ordre établi.
En effet, du côté des « autres citoyens »3 (comme l’analyse Silyane Larcher), les martiniquais n’accèdent qu’inégalement aux droits et promesses de la République. Qu’il s’agisse de la responsabilité de l’Etat dans l’empoisonnement au chlordécone, des mouvements contre la vie chère réclamant davantage de transparence, ou encore des taux particulièrement élevés de chômage et de précarité — des éléments qui traduisent les symptômes d’une situation postcoloniale dont les réalités vécues démentent les promesses d’égalité républicaine. Cette situation fait écho, malgré des contextes très différents, à ce que vivent les citoyens égyptiens sous un régime militaro-autoritaire: une impression d’abandon et de déconnexion entre les gouvernants et le peuple.
Autre point commun significatif entre ces deux sociétés marquées par un passé colonial, à l’instar de la logique binaire présente dans le roman égyptien — qui décrit une sorte de dualité culturelle entre l’ex-colonisateur et l’ex-colonisé —, on retrouve en Martinique une vision similaire dans laquelle la population semble se renfermer. Cette tension exprime une quête identitaire permanente tiraillée entre deux modèles culturels différents, et surtout marqués par un rapport de pouvoir inégal. Une situation que Frantz Fanon expliquait dans l’image des « Peaux noires, masques blancs », et qui éclaire les nombreuses contradictions qui traversent nos sociétés. Dans les deux cas, on constate une instrumentalisation du langage démocratique qui fait fi des idéaux réels d’émancipation, pour mieux asseoir un pouvoir. D’où cette question cruciale pour les sociétés marquées par la domination coloniale :
Qui a le pouvoir de produire un savoir (politique) ? et qu’est-ce que ce savoir (politique) produit comme pouvoir ?
Entre engagement héroïque et passivité populaire :
D’autres thèmes abordés dans le roman font fortement écho avec la réalité de notre péyi. Notamment celui de la mobilisation des masses. Le roman soulève des questions profondément frustrantes qui caractérisent le vécu des militants : pourquoi le peuple ne s’engage-t-il pas ? La peur de l’engagement, mais aussi l’attachement à un certain confort – aussi minime soit-il, reste garant d’un équilibre connu. Il évoque des questions douloureuses : le peuple Egyptien est-il par nature un peuple soumis, destiné à suivre l’ordre établi par l’Etat comme des wouf-wouf plutôt que de risquer l’instabilité du changement ? La dévotion à une cause semble parfois ne susciter que de l’indifférence, alors même que le militantisme exige des sacrifices personnels constants.
« (…) nous avons fait une révolution dont personne n’avait besoin et dont personne ne voulait. Je sais que tu crois toujours au peuple, mais moi je ne crois plus en lui. Ce peuple, pour lequel les meilleurs d’entre nous sont morts en défendant sa liberté et sa dignité, ne veut ni liberté ni dignité ».
Autre point essentiel : la propagande médiatique.
Le roman montre les mécanismes pervers de la propagande médiatique. Une thématique centrale qui révèle à quel point la bataille pour le pouvoir se joue aussi dans le champs des discours. D’un côté, le gouvernement dispose de tous les leviers pour façonner sa vérité, en mobilisant les figures influentes de la société — acteurs, médias dominants, grands sportifs, théologiens (cheikh) — au nom d’une défense de la nation absolue, présentée comme un devoir envers sa patrie. Et de l’autre, les révolutionnaires inventent des moyens alternatifs pour faire circuler leurs contre-discours, organisant des rassemblements « sauvages » (clandestins) afin de diffuser les images des brutalités et des crimes commis par les forces armées contre le peuple. Aussi, en détaillant, les manigances du pouvoir pour manipuler l’opinion, semer la confusion, et étouffer toute tentative de mobilisation populaire, l’auteur nous renvoie à la responsabilité du peuple face aux discours médiatiques.
« Les Égyptiens se sont laissés influencer par les médias parce qu’ils en avaient envie. La plus grande partie des Egyptiens est satisfaite de la répression. Ils acceptent la corruption et y participent. S’il y en a qui ont détesté la révolution depuis le début, c’est parce qu’elle les mettait dans l’embarras. Ils ont commencé par détester la révolution et ensuite les médias leur ont donné des raisons de la détester ».
Rapport entre fiction et fonction politique du récit :
Ce qui est frappant chez El Aswany, c’est sa capacité à faire ressortir les contradictions qui habitent et animent la société égyptienne : poids des croyances religieuses, hiérarchie sociale, rapports de genre, violence des normes amoureuses… Des tensions qui traversent la vie des personnages et influencent leur rapport à l’engagement politique.
Ma seule réserve concerne les personnages, qui m’ont parfois semblé davantage représenter des archétypes sociaux que des individus véritablement complexes ou authentiques. Peut-être est-ce un choix délibéré de l’auteur pour servir l’efficacité du message politique où la dictature écrase toute individualité. De fait, la présence écrasante du pouvoir et le sentiment de fatalité constante pèsent lourdement sur le récit, et rend l’atmosphère oppressante. (comme ça vous avez le TW du roman avant de l’entamer !).
Excellente lecture !
Sources :
- Alaa El Aswany, persécuté en Égypte pour ses écrits : Mon seul crime est d’être un écrivain . Le Figaro, 21 mars 2019 ↩︎
- Les coptes sont les habitants chrétiens d’Égypte (majoritairement issus de l’Église copte orthodoxe), représentant une minorité au sein de la population. L’une des stratégies de l’Etat consistait à attiser les tensions déjà existantes entre musulmans et Coptes, exacerbant les divisions religieuses et détourner l’attention du peuple.
↩︎ - Brun, S. (2021). Larcher (Silyane), L’autre citoyen. L’idéal républicain et les Antilles après l’esclavage, Paris, Armand Colin, 2014, 393 p. Politix, n° 131(3), 160‑163. https://doi.org/10.3917/pox.131.0160. Les « autres citoyens » représentent la population des Antilles françaises qui a longtemps été exclus de l’universalité républicaine, soumis à des régimes d’exception et privés d’une pleine participation politique. ↩︎